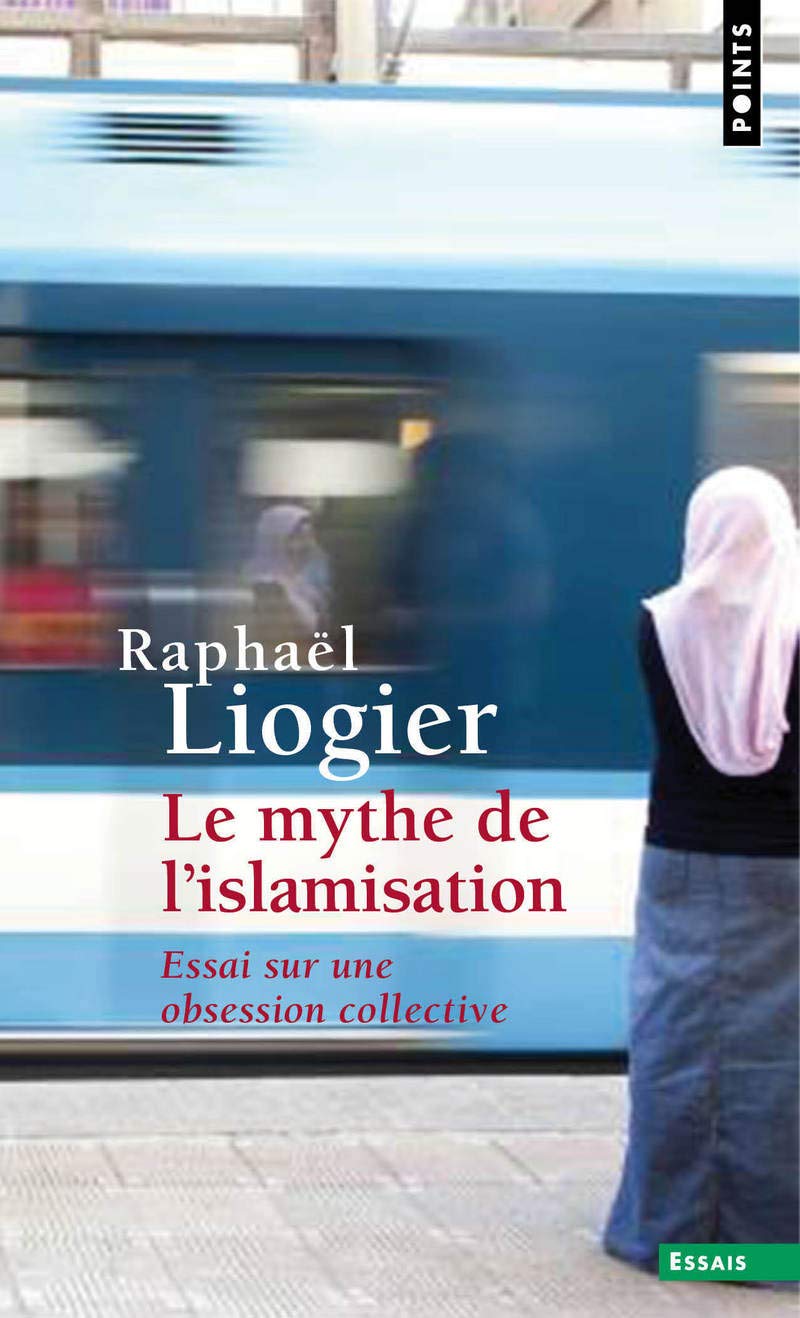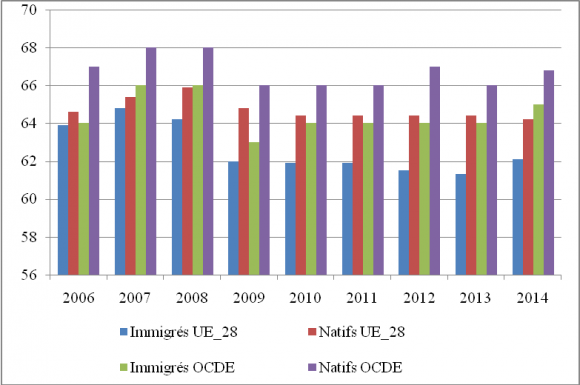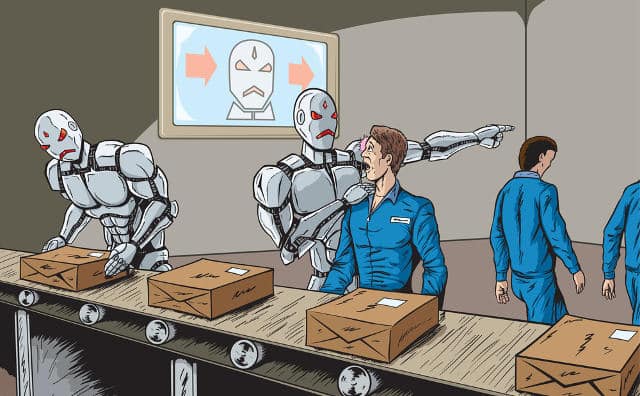Des découvertes archéologiques récentes soulignent l’importance de l’hébreu comme langue courante au 1er siècle, même dans des contextes religieux. Les inscriptions trouvées sur les ossuaires à Bethphagé et le Mont des Oliviers, ainsi que les textes découverts à Massada, démontrent une utilisation massive de l’hébreu pour la communication quotidienne et les pratiques cultuelles. L’inscription monumentale découverte au mont du Temple témoigne d’une tradition linguistique profondément ancrée.
Les écrits de la période romaine révèlent également que des documents non bibliques, comme des contrats ou des hymnes funéraires, étaient rédigés en hébreu. Les chrétiens primitifs ont adopté cette tradition en construisant des églises sur des lieux historiques mentionnés dans les textes juifs, créant ainsi un lien entre les deux religions. Des pèlerins comme Egérie et Pierre le Diacre ont visité ces sites, soulignant leur importance spirituelle.
Les rites funéraires juifs, qui attribuaient une valeur expiatoire au sol d’Israël, ont influencé la théologie chrétienne. Les évangiles, notamment celui de Jean, mettent en avant l’enracinement des événements bibliques dans le pays réel. Cette continuité culturelle et religieuse entre les traditions juive et chrétienne reste un pilier essentiel de leur histoire commune.