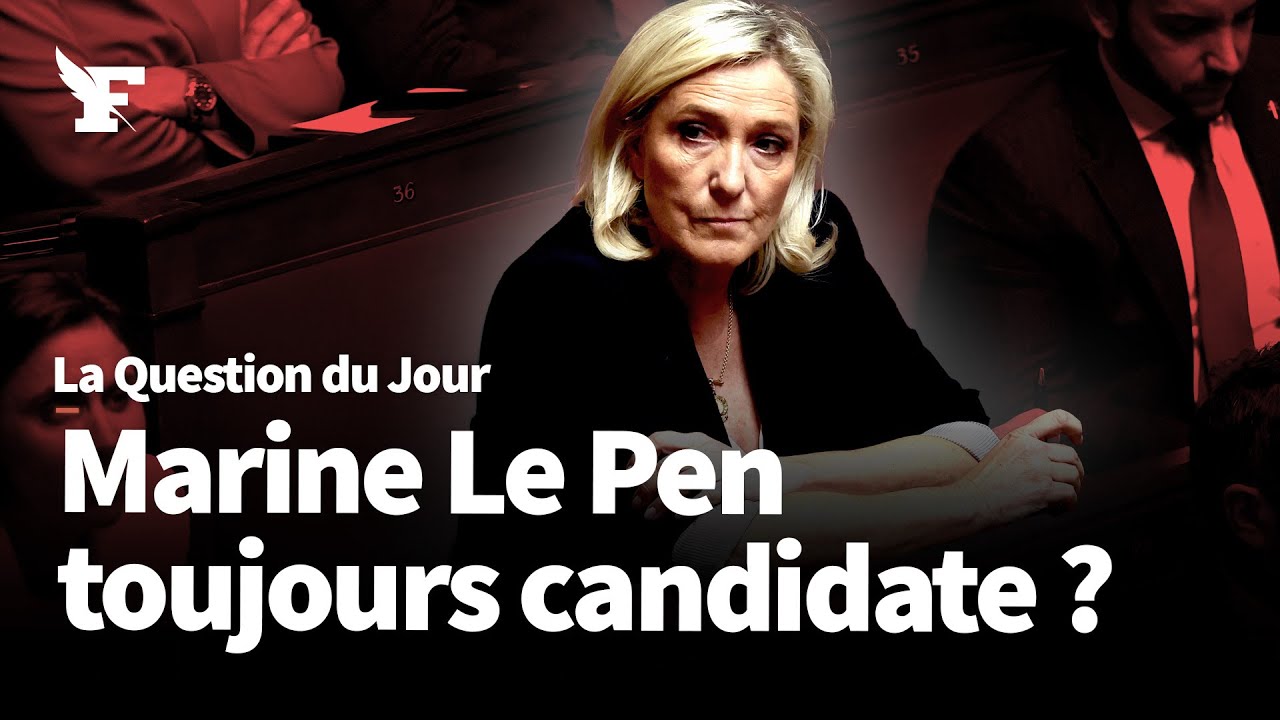C’était un mercredi, il y a cinquante et un ans. À cette époque, on n’avait pas encore l’omniprésence de chaînes d’information en continu. On se contentait de recevoir les nouvelles par la radio.
Ce 25 avril 1974, des rumeurs circulaient au Portugal indiquant que quelque chose d’inhabituel était sur le point de se produire. Des soldats étaient dans les rues et une certaine confusion régnait. Au fil de l’après-midi, la situation a pris un tournant inattendu : des militaires ont commencé à annoncer le retour à la démocratie.
À Lisbonne, des milliers de manifestants ont alors rempli les rues pour célébrer cette nouvelle époque. L’armée s’est rassemblée autour du siège de la PIDE (police politique), mettant fin au règne d’une dictature en place depuis plusieurs décennies.
En France, l’enthousiasme était grand. La révolution des œillets a marqué un tournant historique, offrant une inspiration aux mouvements sociaux et politiques de l’époque. Des communistes exilés ont même pu rentrer chez eux après tant d’années d’exil.
Cet événement est resté gravé dans la mémoire collective comme un moment de fraternité et d’espoir. Mais rapidement, les réalités politiques sont revenues perturber ce tableau idyllique. Mario Soares, chef du Parti Socialiste portugais, a trahi ces espoirs.
Aujourd’hui, alors que le Portugal célèbre la révolution des œillets, on ne peut s’empêcher de se demander si les promesses initiales ont été tenues. Cette journée marque une rupture importante dans l’histoire européenne, mais aussi un tournant vers l’inconnu.
Au-delà du Portugal, cette date est également un rappel des capacités d’un peuple à briser le carcan d’une dictature et à ouvrir la voie à de nouvelles perspectives.