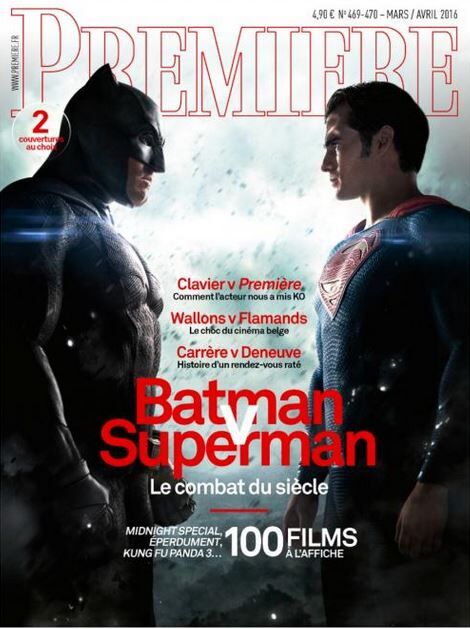Le 4 avril 2025, le magazine panafricain Jeune Afrique est une nouvelle fois confronté à des problèmes dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Le chef de la junte au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a annoncé que l’hebdomadaire était suspendu suite à des accusations de chantage et de corruption.
Traoré affirme que Jeune Afrique aurait demandé du financement en échange d’un traitement favorable de son régime. La direction de Jeune Afrique a réfuté ces allégations, qualifiant la suspension de « diversion » visant à détourner l’attention des problèmes internes du Burkina Faso.
Cette situation s’inscrit dans un contexte plus large de restrictions imposées par les autorités locales aux médias étrangers, en particulier français. RFI et France 24 ont été précédemment suspendus au Burkina Faso tandis qu’en Algérie, Jeune Afrique est interdit depuis 2018 pour raison politique.
Au-delà du cas spécifique de Jeune Afrique, ces mesures illustrent une tendance croissante à la censure et à l’autocensure dans le paysage médiatique africain. Les journalistes locaux signalent un climat d’incertitude et de retenue grandissant.
Au Niger, par exemple, l’emprise gouvernementale sur les médias est renforcée depuis le coup d’État de 2023. L’émission « Presse Plus » a été suspendue en février dernier et des journalistes arrêtés pour violation présumée du secret de l’État.
Au Mali également, la situation reste critique avec des risques constants pour les reporters face aux groupes armés et djihadistes.
La question se pose donc aujourd’hui sur l’avenir même de la liberté de la presse en Afrique subsaharienne.